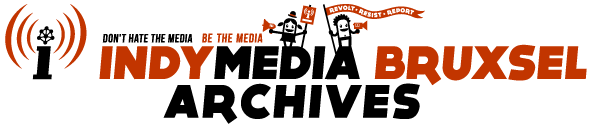ATTENTION RELIGION !
INTRODUCTION
Alors que depuis deux cents ans il a été démontré que toutes les religions sont fausses, elles survivent. Six milliards d’humains, combien de milliards de croyants ? Pourquoi les religions résistent-elles ?
On comprend qu’elles s’accrochent aux zones les moins éduquées, mais les grands résultats de la science qui contredisent les religions — l’évolution, l’astronomie, la génétique — sont connus partout. Les religions survivent jusque dans les pays à très haut niveau de savoir scientifique et technique et, dans ces pays, jusque chez les personnes les plus cultivées.
Il n’y a pas si longtemps que les clergés florissaient parce qu’ils étaient des instruments, conscients et volontaires, des autorités politiques. Pour mettre la formule de Marx au goût du jour, les prêtres étaient bien les dealers du peuple. Cependant, dans tous les pays développés l’influence des églises a diminué. Dans les pays protestants, les chrétiens sont divisés en centaines d’églises différentes, dans la plupart des pays catholiques européens le prestige de Rome est en chute libre. Pourtant la foi résiste. La foi en n’importe quoi, certes : ce que perd le Vatican, les gurus, les scientologues, les astrologues le gagnent. Mais la foi quand même.
Il reste deux solutions : ou bien il y a dans l’esprit humain quelque chose qui le pousse vers la foi, ou bien il y a dans la foi quelque chose qui séduit l’esprit humain.
La première solution plaît aux croyants. Si l’on dénichait dans l’être humain un « gène de Dieu », par exemple, ce serait Dieu qui l’y aurait glissé ! Et puis, celui qui pense que l’existence de Dieu n’a aucune importance, mais qu’en revanche il faut que les peuples croient en un Dieu pour que la morale survive, pour que les peuples obéissent, celui-là souhaite vivement qu’on découvre ce gène ou cette attirance.
Pas de chance pour lui, on est loin d’avoir identifié avec certitude un seul gène qui régisse un comportement humain. Alors une opinion...
En outre, on s’aperçoit que la génétique est bien compliquée, que, lorsque l’on réussit à soupçonner quelles possibilités donne, peut-être, tel ou tel gène, il faut que l’environnement favorise la réalisation de cette possibilité. Pour quelque chose d’aussi peu concret que la religion, l’environnement c’est la culture humaine, indépendante des gènes.
Bref, pour l’instant il n’y a pas de gène de Dieu, et guère de chances qu’on en découvre jamais.
C’est donc la deuxième solution ; il y a dans la foi quelque chose qui séduit l’esprit humain. Mais quoi ?
Un livre, Et l’homme créa les dieux, de Pascal Boyer (Folio), propose une réponse. Une réponse complexe qui se fonde sur une douzaine de théories, indépendantes les unes des autres. Cet ensemble de réponses est une proposition, encore ouverte au débat ; la neurobiologie, c’est-à-dire l’étude concrète, pratique, du cerveau et de son fonctionnement devra un jour en confirmer ou en infirmer des éléments essentiels.
Mais cette réponse est la première à proposer une solution très convaincante à l’ensemble des phénomènes religieux. Une solution séduisante. À nouveau, la neurobiologie en confirmera, ou en infirmera, ce qui la concerne.
Entre-temps, il s’agit de comprendre cette proposition. Le livre compte 500 pages. Serrées. Il fait appel à des théories encore difficiles à comprendre parce qu’elles sont nouvelles, peu familières. Mon but est de dire en 50 pages l’essentiel de ces 500 pages. Pour autant, je ne me refuse pas la liberté de m’en écarter de temps en temps, en particulier à l’égard de l’usage de la religion par les classes dominantes. Cette brochure est un résumé, mais un résumé infidèle à l’occasion.
Une dernière précaution, avant d’entrer dans le vif du sujet : cette brochure se fixe pour but de clarifier et de discuter un résumé des thèses du livre intitulé Et l’homme créa les dieux. Elle ne s’intéresse nullement aux autres écrits ou déclarations de Pascal Boyer, avant ou après.
INSUFFISANCE DES EXPLICATIONS TRADITIONNELLES
Les quatre grandes explications
Cette contradiction entre l’absurdité des religions et leur persistance dans les esprits exige une explication de leur pouvoir. Avant le livre que résume cette brochure, on proposait en gros quatre explications différentes, qui n’étaient pas incompatibles les unes avec les autres.
1. La religion sert à expliquer : la nature et ses phénomènes, l’origine du monde, l’origine de l’être humain, de la vie, du mal, de la souffrance, de la conscience, la nature même de cette conscience, les expériences déroutantes telles que les rêves, etc.
2. La religion sert à nous réconforter. Notre mère meurt ? Non, elle part juste au Paradis, nous l’y retrouverons. Nous avons un cancer horriblement douloureux ? C’est que Dieu veut tremper notre âme pour la rendre digne du Paradis. Nous comprenons que la vie humaine n’a aucun sens autre que celui que nous, humains, voulons lui donner ? Non, le but de la vie humaine est de : a/ chanter la gloire de Dieu ; b/ arriver au Nirvana ; c/ se réincarner en brahmane... La religion est souvent un gonflement à l’échelle cosmique de la protection offerte par la famille : le christianisme est la religion où ce gonflement ne se cache pas, avec sa famille si bien équipée pour le complexe d’OEdipe : un Fils révolutionnaire né d’une Mère vierge et d’un père impuissant, avec en plus, là-haut dans le ciel, un Père dont on va chambouler les lois. Glissons...
3. La religion sert à justifier l’ordre social et moral : Marx a résumé cette explication dans sa célèbre formule : « La religion est l’opium du peuple. » Toutes les religions sans exception ont une opinion précise sur l’ordre social, et si dans les doctrines quelques-unes, très peu, parlent d’égalité, les églises et les clergés remettent vite les choses à leur place. En premier lieu parce que le clergé lui-même est toujours par définition supérieur, et qu’ensuite, le plus souvent, les églises justifient un ordre social inégal.
En outre, la religion sert à renforcer la morale ; il faut la respecter pour obtenir telle ou telle récompense : a/ contempler la Face de Dieu ; b/ revenir à Jérusalem ; c/ disposer de 72 esclaves sexuelles pour l’éternité. Et pour ne pas être puni, en général dans une rôtisserie éternelle, si on ne la respecte pas.
4. La religion est la pensée du moindre effort. On croit ; parce que c’est facile ; parce que cela évite de faire l’effort de penser ; parce que l’athéisme est une philosophie froide, déprimante ; parce qu’on se sent à l’aise dans les traditions de son groupe social et qu’on ne voit pas l’intérêt de les critiquer ; parce que croire est plus rapide que douter ; parce qu’on est trop ignorant pour connaître, ou comprendre, ou accepter la science moderne et les arguments modernes contre les religions.
Seulement voilà : le fait que les religions survivent prouve que ces quatre explications ne suffisent pas. Boyer tend à dire qu’elles sont fausses ; peut-être ne sont-elles qu’incomplètes. Quoi qu’il en soit, la lutte pour l’athéisme commet une grave erreur si elle s’en tient à ces quatre explications.
Il est plus difficile de vaincre un adversaire qu’on ne comprend pas.
Ce qui manque aux quatre grandes explications
L’explication n° 1, la religion-explication, est incomplète parce qu’elle affirme que chacun veut savoir d’où vient, par exemple, le mal, veut en connaître l’origine, veut l’expliquer. En réalité, l’attitude la plus commune, l’attitude par défaut diraient les informaticiens, consiste à vouloir savoir comment traiter, comment diminuer le mal. Les ethnologues s’accordent à dire que les peuples persuadés de l’existence des sorciers ne cherchent à guère à savoir pourquoi il existe des sorciers, ils veulent savoir comment les combattre.
De même, la plupart des chrétiens ne croient plus que le monde ait été créé en sept jours par un barbu, ou la femme tirée d’une côte de l’homme ; cela ne les empêche pas de continuer à croire au barbu.
Enfin, les « explications » religieuses résistent si peu à l’examen que, même dans les cultures les plus isolées, les moins portées à la réflexion, leur absurdité a dû apparaître : lorsque des Hindous entendent que le monde est porté par une tortue géante, ils se demandent : « Mais alors, qui porte la tortue ? » Combien, malgré l’évidente impossibilité de la réponse, ont cessé de croire ?
L’explication n° 2, la religion-consolation, est incomplète parce que la consolation apportée par la religion est à la fois i/ contrebalancée par l’angoisse qu’elle provoque ; ii/ souvent indépendante de la notion de salut ; iii/ contredite par le fait qu’à peu près personne ne pense uniquement à Dieu en cas de danger.
i/ Des centaines de peuples, africains en particuliers, vivent dans la terreur de sorciers indétectables, pire, inconscients d’être des sorciers ; le calvinisme, en damnant la très grande majorité des humains, laisse les élus dans l’incertitude constante de leur statut réel, de même que le catholicisme et ses péchés mortels ; quant le chrétien se croit, lui, sauvé, il peut douter du salut de celles et ceux qu’il aime ; l’hindouiste passe sa vie dans la terreur des pollutions rituelles ; le bouddhiste a chaque jour la preuve qu’il n’a pas cessé de désirer.
ii/ Le judaïsme ne dit à peu près rien d’un éventuel paradis ; l’hindouisme dilue le sujet dans sa grande marmelade ; et un très grand nombre de religions tribales n’en connaissent aucun. Le salut et la vie éternelle ne sont pas la préoccupation éternelle que l’on croit !
iii / La foi n’est jamais si forte qu’elle éteigne les instincts. Les passagers d’un bateau en train de sombrer vont prier, mais en oublieront-ils leur ceinture de sauvetage ? Et les marins, quand la tempête s’est levée, ont-ils prié, ou ont-ils cargué les voiles ? Les Témoins de Jéhovah préfèrent souvent mourir que de se soumettre à une transfusion de sang, mais depuis des milliers d’années que les religions existent, ont-elles jamais empêché l’existence des médecins ? Si les croyants sont si sûrs que leur Mamie va les attendre au Paradis, pourquoi pleurent-ils ?
Attention, gardons ces exemples en mémoire, ils vont servir à un point central de l’argumentation de Boyer ; il existe des gens à la fois persuadés qu’ils retrouveront Mamie au Paradis et, sans la moindre logique, effondrés de chagrin.
L’explication n° 3, la religion justification de l’oppression sociale et morale est incomplète parce que les préceptes de la morale ne sont pas à l’origine de la morale. Ils sont, à l’inverse, sa rationalisation. D’abord, il y a des comportements moraux. Puis des jugements moraux et enfin, en fin, le souci de transmettre ces jugements moraux, de les rendre explicites, d’en faire des préceptes, des normes. En d’autres termes, de même que la théorie du « Contrat Social » est fausse, la société n’a jamais commencée nulle part avec des hommes adultes complètement libres décidant soudain de vivre ensemble, de même la théorie des « Tables de la Loi » est fausse, la morale n’a jamais commencée nulle part avec des hommes adultes complètement amoraux décidant soudain d’avoir une morale ; en particulier imposée par deux barbus sur une montagne !
D’une part, les animaux ont déjà, entre eux, des comportements qui produisent les mêmes résultats que ce qui chez les humains s’appellerait politesse, solidarité ou esprit civique. Les règles morales implicites, tacites, ont existé longtemps avant les clergés.
D’autre part, cette explication de la religion est influencée par l’histoire de, surtout, l’Occident. Où sévissent depuis plus longtemps qu’ailleurs deux formes d’oppression, l’État et l’Église. Mais l’État et l’Église n’ont pas été la norme des cent mille ans d’histoire humaine. La foi a précédé les clergés comme elle a précédé les États. Et en Chine et au Japon, dans la recette de l’oppression sociale, la religion est présente, mais de façon clairement seconde.
Attention ; ceci ne signifie pas que les classes dominantes ne se servent pas de la religion pour maintenir la résignation et l’obéissance des classes dominées. Elles le font. Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi la religion se maintient.
L’explication n° 4, la religion comme paresse mentale, est incomplète à cause des millions de pages de textes difficiles, subtils, raffinés, qui ont coulé des plumes des Pères de l’Église (une bonne cinquantaine de volumes épais), des théologiens catholiques (la Somme de Thomas d’Aquin, éditée en plusieurs volumes, n’est qu’une goutte dans l’océan), protestants et orthodoxes, des théologiens bouddhistes et hindouistes (des millions de lignes...).
Puis parce que cette théorie de la religion comme sommeil de la raison pèche par un défaut logique : si la religion existait seulement à cause de la crédulité humaine, les idées religieuses de base devraient être extrêmement variées.
Pourtant, l’incroyablement fertile imagination humaine court, en ce domaine, toujours dans le même cercle restreint ; ainsi, dit Boyer, l’idée que les morts protègent ou au contraire menacent les vivants est très courante ; l’idée que les organes des vivants changent de place pendant leur sommeil est très rare.
L’idée que la récitation de certaines paroles peut changer le monde physique est très courante, l’idée que manger des courgettes rend immortel est très rare.
La certitude que la générosité des humains est récompensée par des êtres invisibles est très courante, la certitude que la capacité à bien laver les chaussettes est récompensée par des êtres invisibles est très rare.
« Le problème n’est donc pas d’expliquer comment les gens peuvent admettre des assertions naturelles non prouvées mais pourquoi ils ont tendance à admettre ces assertions-là plutôt que d’autres également possibles. » (p. 47)
Comme le dit Boyer, on ne croit pas parce que l’on renonce à critiquer ; on renonce à critiquer parce que certaines assertions, bien qu’extraordinaires, semblent évidentes.
Boyer note en plus deux phénomènes qui doivent nous mettre la puce à l’oreille :
La religion officielle recouvre rarement toutes les pratiques religieuses d’une population, et, (faut-il écrire « parce que » ?) la religion est en réalité plus souvent vécue comme un savoir pratique et non une doctrine.
[...]
Jean-Manuel Traimond
ATTENTION RELIGION !
Pourquoi la religion colle (et quelques conseils pour la décoller)
Atelier de Création Libertaire - Avril 2007
pp.3 > 12.